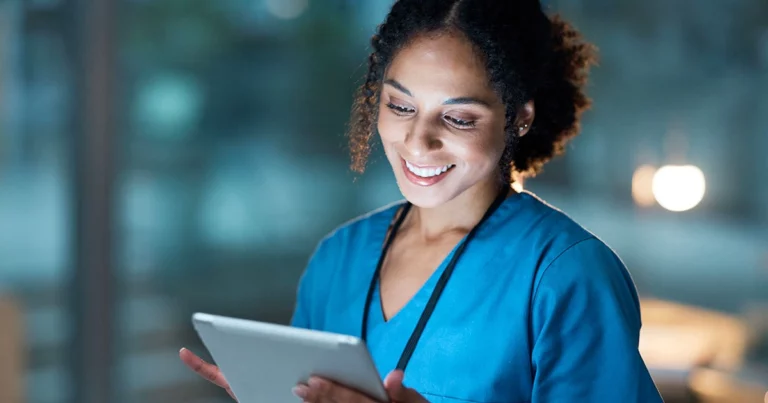Aujourd’hui, de plus en plus de personnes créent leur entreprise. Cependant, cette démarche peut sembler complexe au début. En effet, dès les premières étapes, un nouveau vocabulaire comptable s’impose et peut vite déstabiliser. Ainsi, pour bien gérer son activité, il faut apprendre ces notions dès le départ.
Que vous soyez entrepreneur, freelance ou dirigeant de startup, une base solide est indispensable. En effet, il est essentiel de comprendre la comptabilité, les termes financiers et les expressions fiscales de base. Cela permet de développer son activité et d’assurer sa pérennité dans un environnement parfois technique. Par exemple, maîtriser ce lexique aide à traiter chaque facture correctement et à respecter les délais fiscaux. De plus, cela facilite la tenue d’un journal comptable et la vérification des données financières transmises.
Pour bien démarrer, il faut donc connaître 10 termes comptables indispensables. L’objectif est simple : rendre cet univers plus clair et plus accessible à tous. Ainsi, chaque nouvelle entreprise pourra mieux gérer ses comptes, ses factures et ses obligations fiscales.
En conséquence, cet outil vous aidera à comprendre les informations comptables et les notions comme l’actif ou la TVA. Il simplifiera aussi vos tâches quotidiennes tout en structurant votre gestion dès le lancement de l’entreprise.
Le bilan
Le bilan est un document comptable qui retrace, à un instant donné, le patrimoine de la société, en distinguant l’actif et le passif. L’actif regroupe les éléments de la société, à savoir les immobilisations, la trésorerie, les créances, alors que le passif contient les dettes et les capitaux propres.
Pour cela, il va permettre d’analyser la situation financière, fiscale ou sociale des entreprises sur un exercice. Il est également nécessaire pour la gestion, le suivi des capitaux, les comptes comptables et les relations avec l’expert-comptable. De plus, il est souvent demandé lors des démarches administratives ou des contrôles assujettis à la TVA ou à la mise en conformité des données fiscales.
L’exemple d’une petite boulangerie au 31 décembre.
- L’actif de son bilan montre un four d’une valeur de 10 000 €, des stocks de farine pour 2 000 € et 3 000 € en caisse.
- Au passif, on retrouve un emprunt bancaire de 8 000 € et les apports du propriétaire correspondent à 7 000 €.
Le bilan permet de voir rapidement la santé financière de la boulangerie à la fin de l’année.
Le compte de résultat
Le compte de résultat donne une image claire de la performance et de l’activité principale de l’entreprise. Ce dernier, récapitule les produits (chaque vente, service) et les charges (salaires, TVA, amortissements, dépenses diverses) sur un exercice comptable. De ce fait, il permet de déterminer le résultat net. C’est un document essentiel pour les sociétés et fait partie intégrante du contrôle de la gestion financière. Il permet de connaître le résultat de l’entreprise, et donc de savoir si l’entreprise a fait des bénéfices ou si elle subit des pertes.
Prenons Marie qui vend des crêpes sur les marchés.
- Au cours de son premier mois d’activité, elle a écoulé 1 500 crêpes à 2 € chacune.
- Ce qui représente un chiffre d’affaires de 3 000 €.
- Pour effectuer ces ventes, elle a engagé 150 € en matières premières, 200 € en matériel de cuisine, 20 € pour des taxes afin d’accéder aux marchés, 100 € pour l’amortissement de sa crêpière et 20 € en intérêts sur un prêt.
- En somme, cela représente un total de 490 € de dépenses.
Son compte de résultats affichera 3 000 € de revenus et 490 € de dépenses, ce qui lui laisse un profit de 2 510 € pour le mois.
Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond à la somme des ventes de biens et/ou de services (en hors taxes ou TTC lorsqu’il inclut la TVA) de l’entreprise sur un exercice. C’est un indicateur clé de l’activité économique et sociale des entreprises. En effet, il sert de base de calcul pour l’impôt, la TVA, les taux de cotisations sociales et oriente également la stratégie de gestion. Il est aussi référencé dans les logiciels comptables afin d’établir le plan comptable.
Par exemple, une entreprise de nettoyage propose des prestations aux particuliers et aux entreprises.
- Au cours du mois de mars, elle a réalisé 40 interventions individuelles avec une facturation unitaire de 50 € (soit 2 000 € sur la période).
- Ainsi que 10 contrats de nettoyage de bureaux à 200 € l’unité (soit 2 000 € également sur la période).
- Par conséquent, pour le mois en question, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève à 4 000 € (hors taxes selon la méthode de calcul choisie).
Ce montant représente la totalité des ventes réalisées pendant la période, sans tenir compte des dépenses engagées pour fournir ces services.
La marge commerciale et la marge de production
Marge commerciale :
La marge commerciale est la différence entre le prix de vente d’un bien et son coût d’achat.
Par exemple, un établissement se procure des gilets de travail pour 30 € hors taxes (HT) et les met en vente à 50 €. Le bénéfice commercial lié à chaque gilet est donc, ici, de : 50 € – 30 € = 20 €.
En effet, pour chaque gilet vendu, l’établissement réalise donc une marge brute de 20 €, c’est-à-dire avant les coûts rattachés à d’autres dépenses comme les salaires, les loyers, la TVA…).
Marge de production :
Pour une entreprise qui fabrique elle-même ses produits, la marge de production est la différence entre le prix de vente et le prix de revient de fabrication (matières premières, main-d’œuvre, énergie…).
Exemple : un artisan fabrique une table pour un coût total (matières premières et temps de travail) de 180 € HT et la vend 250 € HT.
Sa marge de production est de 250 € – 180 € = 70 €.
Le taux de rentabilité
Le taux de rentabilité est un ratio de comptabilité entre le résultat net et le chiffre d’affaires. Il permet de mesurer l’efficacité financière des entreprises.
De ce fait, un taux élevé correspond à une bonne utilisation des ressources financières, sociales et humaines. Cet indicateur est utilisé dans le plan de gestion, pour référencer les performances, planifier les investissements et améliorer les services proposés par l’entreprise.
Prenons ce cas comme illustration :
- Une entreprise de fabrication a réalisé, au cours de l’année, un chiffre d’affaires de 500 000 €.
- De ce fait, elle a dégagé un bénéfice net de 50 000 €.
- Pour cela on divise le bénéfice net par le chiffre d’affaires : 50 000 € / 500 000 € = 0,10, soit 10 %.
Cela signifie que, pour chaque euro de vente, l’entreprise a généré 10 centimes de bénéfice.
La trésorerie
La trésorerie représente l’argent qui peut être utilisé immédiatement : caisse, comptes bancaires, ligne de crédit. Une bonne gestion de la trésorerie permet d’assurer chaque paiement aux fournisseurs, des factures, des charges sociales et fiscales, sans utiliser un crédit coûteux.
Utiliser les fonds disponibles permet de sécuriser les mises en bonne date et garantit la disponibilité d’informations financières.
Par exemple, une entreprise qui dispose de 10 000 € en caisse et de 20 000 € sur compte bancaire a une trésorerie de 30 000 €. Ce qui est utile pour anticiper les dépenses futures et assurer la gestion des flux financiers.
Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Le BFR correspond à l’argent dont l’entreprise a besoin en permanence pour financer son exploitation. Le BFR représente les besoins de financement à court terme d’une entreprise résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux déclassements et aux encaissements liés à l’activité.
C’est une donnée clé de la partie financière du business plan, car elle permet d’indiquer la santé financière d’une entreprise.
L’immobilisation
L’immobilisation est un actif durable qui est détenu et utilisé par une entreprise pour son activité (véhicule, logiciel, machine, brevet…), qui lui permet de générer des avantages économiques.
On la retrouve dans les comptes à l’actif du bilan. C’est une partie importante de la stratégie d’investissement et des amortissements.
Par exemple :
- Une société de menuiserie acquiert un équipement de travail du bois pour un montant de 8 000 € hors TVA.
- Cette machine sera employée sur une longue période pour la production de meubles.
- Elle ne sera donc pas considérée comme une simple dépense de l’année, mais elle sera répertoriée en tant qu’immobilisation corporelle dans l’actif du bilan.
- Annuellement, un segment du coût de l’appareil sera soustrait par le biais d’amortissement.
Ce qui illustre la diminution de valeur de l’équipement avec le temps et sa mise en œuvre durable au sein des opérations de la société.
Les capitaux propres
Les capitaux propres sont des ressources qui appartiennent à l’entreprise. Elles incluent le capital social, les résultats des exercices précédents et les apports des associés. Ils permettent la solidité financière des entreprises, ce qui rassure les partenaires, c’est aussi un levier déterminant la capacité d’autofinancement de la société.
Le compte courant d’associé
Le compte courant d’associé représente une somme d’argent qui est versée par les associés à leur société, en dehors du capital social. En effet, c’est une sorte de financement plus souple qui permet de lancer son activité sans obligatoirement recourir à un crédit bancaire
M. Martin crée une société avec un capital social de 5 000 €.
- Pour aider la société à financer l’achat d’une machine, il décide de lui prêter 4 000 € supplémentaires, qu’il verse sur le compte bancaire de l’entreprise.
- De ce fait, cette somme est enregistrée en « compte courant d’associé » au passif du bilan : il s’agit d’une dette de la société envers M. Martin, qui pourra demander à être remboursé quand la trésorerie le permettra.
Aujourd’hui, il est primordial de maîtriser les principaux termes comptables afin de piloter au mieux son activité, d’analyser ses résultats d’exercices, d’optimiser son bilan, de gérer ses dépenses, de structurer ses données, d’anticiper chaque paiement et d’améliorer sa rentabilité. Il est aussi recommandé de tenir à jour un livre comptable, afin de répertorier toutes les opérations financières.
KER met ses services à votre disposition pour simplifier la comptabilité, optimiser vos affaires, structurer votre travail et assurer un suivi précis des informations financières, sociales et fiscales.
Synthèse des 10 termes à retenir
| Terme comptable | Définition | Utilité principale |
|---|---|---|
| Bilan | Document qui présente le patrimoine de l’entreprise à un instant donné. | Analyse de la santé financière, démarches administratives |
| Compte de résultat | Document qui récapitule produits (ventes) et charges (dépenses) sur un exercice, pour déterminer le résultat net. | Mesure de la performance, gestion financière |
| Chiffre d’affaires | Total des ventes de biens/services sur une période (HT ou TTC). | Indicateur d’activité, base pour impôts et cotisations |
| Marge commerciale | Différence entre prix de vente et coût d’achat d’un bien. | Calcul du bénéfice brut sur revente |
| Marge de production | Différence entre prix de vente et coût de fabrication d’un produit. | Calcul du bénéfice brut sur production |
| Taux de rentabilité | Ratio entre résultat net et chiffre d’affaires. | Mesure de l’efficacité financière |
| Trésorerie | Somme disponible immédiatement (caisse, comptes bancaires, lignes de crédit). | Paiement des charges, gestion des flux financiers |
| Besoin en fonds de roulement (BFR) | Argent nécessaire pour financer l’exploitation courante (décalages de flux de trésorerie). | Indicateur de santé financière à court terme |
| Immobilisation | Actif durable utilisé pour l’activité (machine, brevet…). | Investissement, amortissement |
| Capitaux propres | Ressources appartenant à l’entreprise (capital social, bénéfices, apports). | Solidité financière, autofinancement |
| Compte courant d’associé | Somme prêtée par un associé à la société, hors capital social. | Financement souple |